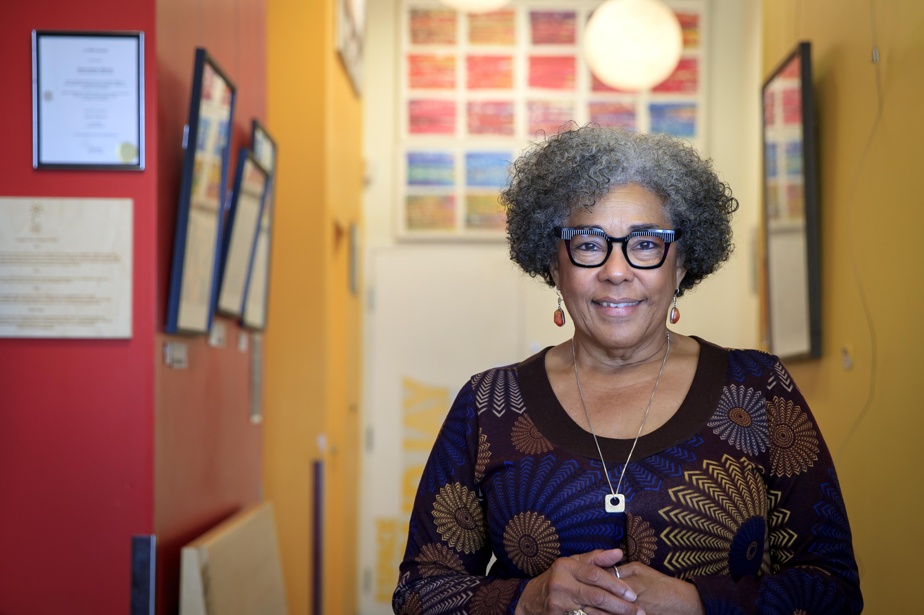La maison de Clara est une petite perle. Tout est impeccable et parfaitement rangé. Le jour de notre visite, son fils, Jesús, est responsable de s’assurer que tout sente le frais. Il nous le dit lui-même avec un sourire de fierté : « C’est moi qui ai nettoyé. » Dans l’appartement, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de Côte-des-Neiges, il y a peu de meubles, mais juste assez pour que nous puissions nous asseoir et prendre un café que Clara a préparé dès notre arrivée. Avec son grand sourire qui contraste avec ses cernes, elle dégage quelque chose de doux et déborde de cordialité.
Elle et son fils sont arrivés au Canada le 30 mai 2024 en provenance de Guanajuato, au Mexique, laissant derrière eux une partie de leur famille. Clara et son mari, mariés depuis 19 ans, ont cinq enfants, mais seuls Clara et Jésus ont pu faire le voyage jusqu’à Montréal.
Jésus, qui est âgé de 18 ans, a une condition médicale complexe – spina bifida et hydrocéphalie –, qui l’empêche de bouger de la taille aux pieds. Il dépend totalement de sa mère pour les soins de base, même si cela ne l’empêche pas de donner un coup de main pour garder la maison impeccable.
Clara peut aussi compter sur le soutien d’un réseau de contacts qu’elle s’est créé en moins d’un an à Montréal. Des amis et des voisins l’aident dans ses démarches avec Jesús et l’assistent si elle doit quitter la maison pour une période plus longue que d’habitude. Pour elle et pour Jesús, la communauté est devenue indispensable.
De commerçants à demandeurs d’asile
« Nous sommes – ou plutôt : nous étions – commerçants, explique Clara. Nous avons eu une entreprise pendant 17 ans : un stand de tacos qui nous a permis de subvenir à nos besoins pendant longtemps, ainsi que de gérer la maladie de Jesús », dit-elle avec une profonde nostalgie en évoquant ce qu’était sa vie avant qu’elle ne devienne, avec son fils aîné, demandeuse d’asile au Canada.
« Mais en février [2024], ils ont commencé à nous demander de l’argent pour que nous puissions continuer à vendre nos tacos », poursuit-elle.
Cette forme d’extorsion – appelée el cobro de plaza, mais également connue sous le nom de vacuna ou de cobrar piso – consiste à exiger de l’argent des commerçants et des entrepreneurs de manière récurrente. À Guanajuato, une des villes les plus violentes du Mexique, ce type de méfait est perpétré par des organisations criminelles liées aux cartels de la drogue.
« Ils ont commencé par nous demander 500 pesos par jour (environ 35 $). Pour vous donner une idée, nous vendions chaque taco 13 pesos (environ 0,90 $). Je sais que cela ne semble pas beaucoup d’argent, mais il faut considérer que nous vivions de ce que nous vendions. Avoir une personne à la maison avec une maladie chronique, qui demande beaucoup de médicaments, de couches et de rendez-vous avec des spécialistes, complique tout », raconte Clara.
Très vite, les criminels ont doublé leur demande, exigeant 1 000 pesos par jour (70 $). « Au cours d’une bonne journée, nous réussissions à vendre pour environ 1 400 pesos (98 $). Alors, quand ils nous ont demandé plus d’argent, nous avons commencé à emprunter. »
Cette extorsion, la plaza, n’est pas la seule raison qui a poussé Clara à fermer son stand de tacos et à immigrer au Canada avec Jesús. Les menaces étaient de plus en plus graves, et des traumatismes du passé, dont l’assassinat de sa belle-sœur il y a quatre ans et celui de la mère d’un camarade de classe de l’un de ses enfants, ont ressurgi, l’amenant à prendre la difficile décision de préparer deux sacs à dos et de partir avec son fils aîné en quête d’un territoire inconnu où ils seraient plus en sécurité.
« Nous savions qu’à un moment donné, nous ne pourrions plus les payer et que nous finirions comme ma belle-sœur... C’est là que j’ai dit : “Partons pour le Canada !” » raconte-t-elle en se serrant les mains.
Les rapports établis sur la violence au Mexique confirment ce dont parle Clara. Selon l’Indice de Paix au Mexique, élaboré par l’Institut pour l’économie et la paix, le taux d’activités perpétrées par le crime organisé à Guanajuato a augmenté de 632 % au cours des huit dernières années. Au cours du mois de janvier 2025 uniquement, le Secrétariat de la sécurité et de la protection des citoyens a recensé plus de 216 homicides dans la ville.
« Nous venons d’un endroit où on tue gratuitement. Oui, c’est l’endroit où nous avons grandi et où nous avons vécu pendant de nombreuses années. Nous connaissons même nos extorqueurs... Mais tout a changé. Maintenant, les cartels recrutent des gamins. Des chamaquitos**… Ils sont de plus en plus jeunes », déplore Clara.
Un endroit sûr pour vivre
Le plan initial de Clara était d’immigrer au Canada avec toute sa famille. Cela n’a pas été possible parce que seuls elle et Jesús avaient un visa américain, Jesús recevant des traitements pour sa condition médicale à Chicago.
Rappelons également qu’à la fin de février 2024, le gouvernement canadien a rétabli l’obligation, pour les Mexicains souhaitant visiter le pays, de détenir un visa. La réglementation en place permet toutefois aux Mexicains ayant un visa américain de se rendre au Canada en obtenant simplement une autorisation de voyage électronique (AVE).
Clara et Jesús sont donc arrivés à l’aéroport Trudeau, à Montréal, en mai 2024 avec 200 $ en poche – une somme réunie après avoir mis en gage le peu qu’ils possédaient – et deux sacs à dos. Elle se souvient parfaitement qu’il faisait encore nuit, qu’elle avait du mal à communiquer avec les agents de l’immigration et que, à sa grande surprise, elle s’est révélée plus forte qu’elle ne pensait l’être.
« J’avais très peur quand nous sommes arrivés. [Les agents de l’immigration] m’ont demandé ce que je faisais à Montréal, si je connaissais quelqu’un, combien d’argent j’avais et où j’allais passer la nuit. Ils m’ont donné un papier avec une adresse et m’ont recommandé d’y aller. J’ai dit que je venais demander refuge », raconte-t-elle.
Après cette première étape migratoire, « j’ai essayé d’être forte, mais je me suis demandé : “Et maintenant, que faisons-nous ? Où allons-nous ?” » poursuit-elle.
« Je voyais des gens dormir à l’aéroport ; alors, j’ai pensé que c’était ce que nous pouvions faire. Ensuite, un homme s’est approché de moi, il m’a parlé en anglais. C’était un chauffeur de taxi. Je lui ai montré le papier que l’agent m’avait donné et je lui ai dit que je n’avais que 200 $. Il m’a dit qu’il me conduirait, et c’est là que j’ai trouvé toutes mes forces, parce que j’ai réussi à porter Jesús, qui est déjà un adulte, et à le monter dans la voiture. C’est là que notre aventure a commencé. »
Commencer à créer une communauté
Le lendemain, après avoir passé la nuit dans une salle de réunion dans un endroit dont le nom échappe à Clara, elle et Jesús ont pu s’installer dans une chambre d’hôtel et recevoir l’aide d’une travailleuse sociale de Praida.
Avec l’aide de traducteurs et les 120 $ qui lui restaient après avoir payé le taxi qui l’a transportée depuis l’aéroport, elle a réussi à obtenir un numéro de cellulaire et à acheter des articles essentiels, comme des couches pour son fils.
Clara a progressivement surmonté sa peur. Elle a rapidement commencé à chercher des ressources pour les demandeurs d’asile. Elle a ainsi réussi à recevoir l’aide de l’INICI, un organisme portant assistance aux nouveaux arrivants.
Avec Praida, elle a commencé à comprendre ses droits en tant que demandeuse d’asile, tout en apprenant à se retrouver dans la ville en transport en commun. « Praida m’a donné deux cartes OPUS, et c’est ainsi que nous nous sommes déplacés à Montréal », dit-elle avec fierté. Elle et son fils ont également commencé à percevoir l’aide sociale : 820 $ chacun.
Les premiers mois de Clara et de Jesús à Montréal ont été des montagnes russes. Bien qu’elle ait eu l’impression que tout évoluait, son cœur et son esprit étaient toujours au Mexique, car ses quatre autres enfants, âgés de 3, 8, 11 et 16 ans, ainsi que son mari vivaient des difficultés extrêmes en essayant de fuir les violences au Mexique.
« Ils ont été dans plusieurs villes, de León à Comanja de Corona, en passant par Mexico et Jalisco. Ils ont constamment déménagé, avec l’aide de contacts et de prêts. Ils ont beaucoup souffert, ont eu faim et ont souvent manqué d’un endroit adéquat où dormir », explique-t-elle, sans donner plus de détails par crainte pour leur vie.
Mais l’angoisse qu’a constamment éprouvée Clara ne l’a pas empêchée de chercher de l’aide à Montréal. Les agents de l’immigration lui ont dit qu’elle et son fils devaient quitter l’hôtel le 10 juillet. Avec cette date limite en tête, elle a commencé à chercher un appartement dans toute la ville.
Si pour un demandeur d’asile il est compliqué de trouver un endroit où vivre en raison des exigences imposées en pleine crise du logement – que des politiciens ont tenté de mettre sur le dos des immigrants –, pour Clara, la difficulté était double, car les besoins particuliers de Jesús rendaient impraticables plusieurs des options trouvées.
Une autre travailleuse sociale, cette fois de l’Aide aux immigrants à Montréal (AIEM ), s’est jointe à sa recherche de logement et a trouvé un appartement en sous-sol, mais avec un accès par une rampe. Le 8 juillet, un mois et huit jours après être arrivés à Montréal, Clara et Jesús se sont installés dans leur premier appartement, dans Mercier-Est.
Ce logement était bien, explique Clara, mais il n’était pas adapté aux besoins de Jesús. La salle de bains, par exemple, lui était inaccessible.
Parallèlement, la mère a cherché des moyens pour réunir sa famille au Canada. « J’ai communiqué avec un avocat, qu’une nouvelle amie m’a aidée à payer. Il m’a expliqué que le processus pouvait prendre de cinq à six ans, même si des efforts étaient faits pour accélérer les choses », déplore-t-elle. Elle retrouve tout de même immédiatement son optimisme. « L’espoir est la dernière chose qu’on perd », rappelle-t-elle.
Établie et pleine d’espoir, mais avec un vide
L’élan de Clara est indéniable. Comme tant de demandeurs d’asile, elle trouve sa force dans la nécessité. Bien qu’elle n’ait pas encore entamé de recherche d’emploi, elle a commencé toutes les démarches pour que son fils reçoive les soins médicaux dont il a besoin à Montréal. Elle espère pouvoir travailler une fois que ces démarches auront suffisamment progressé.
Maintenant établie à Côte-des-Neiges, elle est plus près de l’Hôpital général de Montréal, ce qui facilite la prise de rendez-vous. À la maison, des travailleurs du CLSC viennent l’aider à donner des bains à Jesús.
« En plus, j’ai la bonne compagnie des voisins, y compris des familles mexicaines, qui m’ont aidée à trouver un sens d’appartenance et m’ont offert du soutien », souligne-t-elle, ajoutant qu’elle a pu constater « qu’il existe une aide mutuelle entre les immigrants – nous échangeons du soutien et des contacts pour surmonter les difficultés. »
Avec l’aide du réseau communautaire qu’elle s’est construit, Clara a organisé un pozole traditionnel mexicain afin de recueillir des fonds pour acheter un nouveau fauteuil roulant à Jesús. Bien que la collecte n’ait pas été aussi élevée qu’elle l’espérait, elle apprécie les rapports de voisinage et le sentiment de communauté avec son entourage.
Jesús progresse également dans son adaptation à Montréal. Tout comme sa mère, le jeune homme – qui affiche en permanence un sourire radieux – est enthousiasmé à l’idée de commencer sous peu à étudier le français dans une classe adaptée pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Il devait commencer les cours de francisation la semaine du 10 février, mais les chutes de neige historiques à Montréal ont retardé son entrée en classe. « C’est très compliqué à cause du fauteuil roulant », dit sa mère.
Au Mexique, les choses ne s’améliorent pas pour la famille de Clara. Son mari a récemment souffert d’une colite et a dû être hospitalisé, tandis que les enfants cherchaient des moyens de faire face à l’absence de leur mère et de leur grand frère.
« La petite de huit ans m’a récemment dit qu’elle ne voulait pas grandir parce que, quand elle me reverra, elle sera déjà adolescente. Je lui ai dit de ne pas voir les choses ainsi, d’être patiente et de prier Dieu pour que tout cela passe vite. Elle pleure beaucoup. Puis, je lui raconte une histoire et elle s’endort », dit-elle d’une voix brisée.
« Parfois, je me demande si tout cela en vaut vraiment la peine. Je me sens coupable, car nous sommes dans un endroit confortable et, surtout, sûr, alors qu’ils continuent à souffrir là-bas. Il y a deux semaines, ils ont trouvé la tête et le corps d’un ami qui travaillait près de notre stand de tacos. Toute cette violence continue, tandis que les cartels recrutent des jeunes. Mes enfants me disent qu’ils ne veulent pas rester au Mexique... C’est ce qui est difficile. »
Malgré tant de défis et de difficultés, Clara conserve une attitude positive, et même reconnaissante. Elle n’a aucune idée de la date à laquelle elle recevra une réponse d’Immigration Canada au sujet de sa demande d’asile et de celle de son fils, mais elle se sent soutenue par sa communauté. Une force qui la pousse à aller de l’avant avec l’espoir de pouvoir bientôt étreindre son mari et ses quatre autres enfants.
* Le prénom a été modifié à la demande de la personne interviewée.
** « Chamaquito » est un terme utilisé dans certains pays d’Amérique latine, particulièrement au Mexique, pour désigner un enfant ou un adolescent.






.jpg)